
Les erreurs à ne pas commettre en français au brevet
Contourne les pièges et ne perd pas de point le jour des épreuves du brevet à l’aide de notre guide des fautes à ne pas faire en 3e en français. Pour chaque partie du programme de français (compétences en lecture et compréhension de texte, en grammaire, en orthographe et en écriture) en 3e, des conseils avec les erreurs récurrentes à éviter.
Pour commencer, les révisions en français, c’est par ici.
Les compétences en lecture et compréhension de texte

Pour réussir l’épreuve de rédaction au brevet, il ne faut pas se tromper au moment de choisir le système d’énonciation en fonction du sujet proposé.
Pour chaque sujet, il faut :
– déterminer la personne appropriée ;
– choisir le temps à utiliser.
Voici quelques conseils en fonction du type de sujet rencontré :
- Dans le cas d’un récit comportant du dialogue
Il ne faut pas oublier que les énoncés ancrés forment le dialogue mais que les énoncés coupés les introduisent.
Par conséquent, les verbes introducteurs du dialogue (énoncés coupés) doivent être au passé simple et non au présent (sauf dans le cas, rare, d’un récit tout entier mené au présent de narration) et les pronoms personnels sont ceux de la 3e personne du singulier.
Pour le dialogue lui-même (énoncés ancrés), les verbes sont au présent et les pronoms personnels utilisés sont essentiellement les 1re et 2e personnes du singulier.
- Dans le cas de la rédaction d’une lettre
L’énoncé est ancré dans la situation d’énonciation. Le temps à utiliser est le présent.
De plus, il faut, en fonction du destinataire, choisir entre vouvoiement et tutoiement et s’y tenir ensuite scrupuleusement. D’une manière générale, il faut prêter la plus grande attention au niveau de langue utilisé : tout écart de langage sera sanctionné par le correcteur.
- Dans le cas de la rédaction d’un article de presse argumenté
L’énoncé est ancré dans la situation d’énonciation. Le temps à utiliser est le présent. On utilisera de préférence le on ou le nous de politesse plutôt que le je. On utilisera également des formes impersonnelles : « il est certain que », « il est incontestable que », « il faut admettre que », etc.
- Dans le cas d’un sujet classique de récit d’une expérience personnelle (autobiographie)
Pour ce type de sujet, il faut utiliser des énoncés coupés de la situation d’énonciation et le passé simple comme temps principal, mais le récit doit être mené à la 1re personne. Quelques énoncés ancrés constituant des commentaires du narrateur peuvent être utilisés.
- L’ironie est utilisée de façon très différente selon les textes. Il faut éviter de la voir partout.
- Si le texte comporte de l’ironie, tout passage entre parenthèses n’introduira pas nécessairement un commentaire ironique. Les parenthèses ou les tirets peuvent aussi correspondre à une explication.
- Lorsqu’une forme verbale comporte deux éléments, il ne faut pas confondre voix active et voix passive. Ex. : Il est parti. (passé composé, voix active) / Il est retenu. (présent, voix passive)
- Lorsqu’on identifie des formes du présent, il ne faut pas oublier que le subjonctif et l’indicatif partagent les mêmes formes pour les trois premières personnes du singulier et pour la troisième personne du pluriel. En cas de doute, il faut remplacer le sujet du verbe par nous ou par vous et l’on reconnaît alors à coup sûr l’un ou l’autre mode. Ex. : Je crains qu’il accepte ce poste. / Je crains que vous acceptiez ce poste. (subjonctif)
- Si l’on a un doute sur le fait qu’un verbe au présent ou à l’imparfait possède une valeur de répétition ou d’habitude, on peut ajouter à la phrase un complément circonstanciel de temps indiquant la fréquence. Ex. : Elle jouait régulièrement au volley.
- Si l’hésitation porte sur la valeur modale d’un verbe au conditionnel, on peut ajouter à la phrase un adverbe comme probablement ou sans doute. Ex. : Elle aimerait rejouer ce morceau. / Elle aimerait probablement rejouer ce morceau.
- Pour ne pas confondre un imparfait et un passé simple de la première personne du singulier des verbes du premier groupe, il faut impérativement retenir la différence de terminaisons :
-ai pour le passé simple :
Ex. : Je remportai la médaille d’or en 2004.
et -ais pour l’imparfait :
Ex. : Je m’entraînais plusieurs mois avant les Jeux d’Athènes.
- Lorsque le texte étudié est autobiographique, on peut se trouver en présence d’énoncés ancrés (pour les commentaires du narrateur) et d’énoncés coupés (pour les faits racontés). Dans ce cas, il faut veiller à distinguer le passé composé utilisé pour les commentaires et le passé simple utilisé pour les événements de l’autobiographie.
- Il ne faut pas utiliser l’expression car en effet : ce sont deux mots synonymes.
Ex. : Je lui ai prêté mon vélo car le sien était en réparation. / Je lui ai prêté mon vélo, en effet, le sien était en réparation.
- Il ne faut pas confondre si introduisant une proposition subordonnée de condition et si introduisant une proposition subordonnée interrogative. Ex. : [Si le Brésil et l’Inde faisaient partie du Conseil de sécurité], l’ONU serait mieux perçue. (subordonnée de condition) / Je me demande [si tu dois vraiment choisir une troisième langue]. (subordonnée interrogative indirecte)
- Il ne faut pas confondre quoique (bien que) en un seul mot et quoi que en deux mots (quelle que soit la chose que...). Ex. : Quoiqu’il ait beaucoup d’arguments, il ne réussira pas à me convaincre. / Quoi qu’il puisse ajouter, je ne pense pas qu’il ait raison.
- Lorsque l’adverbe aussi est placé en tête de phrase, il ne faut pas oublier d’inverser le sujet et le verbe. Ex. : Ils ont critiqué toutes les décisions sur les aides au logement. Aussi serait-il logique qu’ils votent contre la prochaine loi.
- En revanche, après l’adverbe ainsi, le sujet et le verbe restent dans l’ordre habituel. Ex. : L’Europe a fermement condamné l’usage des phosphates dans l’agriculture. Ainsi le gouvernement français est de plus en plus critiqué.
- L’expression pour ne pas que est incorrecte. Ex. : Je lui ai transmis ce dossier pour ne pas qu’il revienne au bureau. (phrase incorrecte) / Je lui ai transmis ce dossier pour qu’il ne revienne pas au bureau. (phrase correcte)
- Pour ne pas passer à côté du discours direct, il ne suffit pas toujours de se fier aux signes de ponctuation classiques (guillemets et tirets). Ceux-ci sont parfois abandonnés par certains auteurs contemporains.
- Le discours indirect libre est le plus difficile à repérer : il faut en priorité observer la ponctuation (les points d’interrogation ou d’exclamation en particulier) et les éventuelles marques de l’oral (les interjections). Mais il faut aussi observer les temps utilisés : le discours indirect libre utilise les temps du récit. Il assure ainsi la continuité du récit et donne l’impression au lecteur que la voix du narrateur et celle du personnage se mêlent.
- Lorsqu’on utilise le discours indirect, il ne faut jamais oublier que les subordonnées interrogatives indirectes se terminent par un point et non par un point d’interrogation. Ex. : Je lui ai demandé si elle s’était bien amusée à cette fête.
Lorsqu’une question de vocabulaire est posée, elle concerne fréquemment un mot important à l’échelle du texte.
Pour ne pas faire de contresens, plusieurs solutions sont possibles :
- Il faut bien distinguer le sens propre et le sens figuré. Ex. : « Mon esprit est pareil à la tour qui succombe / Sous les coups du bélier infatigable et lourd. » (Baudelaire)
➞ Le mot « bélier » désigne soit l’animal, soit une ancienne machine de guerre. C’est ce second sens qu’il faut choisir ici.
- Si le mot inconnu est formé par composition savante, on le décompose pour reconnaître les préfixes et les suffixes latins ou grecs utilisés. Ex. : philologue : philo et logos signifient respectivement aimer et langue.
➞ Un philologue est donc un spécialiste des langues, un linguiste spécialisé dans l’étude des manuscrits.
- Si le mot est formé par dérivation, on analyse sa construction.Ex. : im-putresc-ible.
➞ On reconnaît le radical putre, présent dans putréfaction (état de ce qui se décompose en pourrissant). Le suffixe -ible signifie qui peut. On a donc l’explication de putrescible (qui peut pourrir) et, par suite, celle de imputrescible puisqu’on sait que le préfixe in- sert à former des antonymes.
- Si le mot inconnu est utilisé à plusieurs reprises, il faut essayer de déduire des indices de chacune des phrases où il se trouve employé.
➞ Le mot « joug » est utilisé à deux reprises avec le verbe « porter » à propos de choses pénibles. On songe à un synonyme : contrainte. En fait, le mot désigne à l’origine une pièce de bois utilisée pour atteler une paire d’animaux. Au sens figuré, il désigne une contrainte morale ou matérielle.
- Lorsqu’il s’agit de relever les comparaisons, il ne faut pas se contenter de relever celles qui commencent par comme. En effet, certaines peuvent être introduites par un autre outil de comparaison. Ex. : Son regard est pareil au regard des autres. (Voltaire)
- Pour expliquer correctement une métaphore ou une comparaison, il ne suffit pas d’identifier le comparé et le comparant. La partie la plus délicate de l’analyse est de reconnaître le point de comparaison. Il faut alors produire une explication détaillée. Par ailleurs, bien souvent, il faut prendre appui sur le contexte.
- Pour faire l’analyse de la versification dans un poème, il ne faut pas oublier que le mètre peut parfois varier au fil du texte. Il faut donc observer la mise en page, les « décrochages » éventuels et ne pas se satisfaire d’un décompte sur les deux premiers vers. Il faut en outre bien respecter les règles de prononciation du -e. Ex. : La musique souvent me prend comme une mer ! (12) Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, (12) Je mets à la voile ; (6) (Baudelaire)
- Les assonances et les allitérations sont très souvent confondues par les candidats du Brevet. Il est donc recommandé de mémoriser un exemple de chaque.
Les compétences grammaticales
Certains mots relèvent de plusieurs classes grammaticales. Il ne faut pas se tromper sur leur nature et il faut travailler avec le dictionnaire et des tableaux de synthèse tout au long de l’année.
Voici quelques mots-pièges fréquents :
- que :
– pronom relatif. Ex. : Le roman que j’ai terminé hier sera bientôt adapté au cinéma.
– pronom interrogatif. Ex. : Que veux-tu emporter ?
– conjonction de subordination. Ex. : Je sais qu’elle dit vrai.
– élément d’une locution conjonctive. Ex. : Elle s’entraîne dès que les cours sont finis.
– adverbe exclamatif. Ex. : Que tu es silencieux !
– outil pour introduire le subjonctif. Ex. : Qu’ils viennent me voir demain !
- si :
– adverbe. Ex. : Elle était si vite repartie.
– conjonction de subordination. Ex. : Je me demande si elle a eu son avion.
- quand :
– adverbe interrogatif. Ex. : Quand arrives-tu ?
– conjonction de subordination. Ex. : Je serai là quand tu arriveras.
- tout :
– déterminant indéfini. Ex. : Tout colis suspect doit être signalé.
– pronom indéfini. Ex. : Il a tout vérifié.
– adverbe. Ex. : Il est tout surpris d’être qualifié.
- fort :
– adjectif. Ex. : Le dollar est un peu moins fort depuis un mois.
– adverbe. Ex. : Je l’ai trouvé fort courageux.
- Pour ne pas se tromper et pour être précis lorsqu’on donne la fonction d’un mot ou d’un groupe de mots, il ne faut pas oublier de mener une analyse complète. Ex. : Ce jour-là même, Fabrice rencontra dans la rue la petite Marietta ; elle devint rouge de bonheur, et lui fit signe de la suivre sans l’aborder. (Stendhal, La Chartreuse de Parme)
Dans cette phrase :
– « Ce jour-là même » est un GN qui a la fonction de complément circonstanciel de temps (il ne suffit pas de dire « complément circonstanciel ») ;
– « la petite Marietta » est un GN qui a la fonction de COD du verbe « rencontra » (il ne suffit pas de dire « COD ») ;
– « rouge de bonheur » est un groupe adjectival qui a la fonction d’attribut du sujet « elle » (il ne suffit pas de dire « attribut »).
- Par habitude, on a tendance à considérer que l’élément venant derrière le verbe est un attribut ou bien un COD ou un COI. Pourtant il ne faut surtout pas oublier qu’il existe des sujets inversés. Ex. : Excitante sera toujours la minute où débouche victorieusement le coureur qui, jusque-là, semblait avoir un retard trop grand pour jamais parvenir à le rattraper. (Michel Leiris, Fourbis)
Dans cette phrase, « la minute » est un sujet inversé de « sera » et « le coureur » est un sujet inversé de « débouche ».
- Les pronoms adverbiaux en et y ne sont pas toujours compléments circonstanciels de lieu.
Ex. : Rome, j’y vais en mai. (CC de lieu). / Rome, j’y repense souvent. (COI de « repense »)
- Les subordonnées interrogatives indirectes ne sont pas des phrases de type interrogatif. Ex. : Je me demande [à quelle heure est le premier train]. En effet, le type de la phrase est celui de la principale dans laquelle la subordonnée s’insère (pour notre exemple, une phrase déclarative).
- Dans les phrases interrogatives, le -t- de liaison est souvent noté de façon incorrecte avec une apostrophe. Ce -t- doit bien être encadré par des tirets. Ex. : Aime-t-il les brownies ? En revanche, ce -t- n’a pas lieu d’être si le verbe se termine par un -t. Ex. : Aimait-il les brownies ?
- Il ne faut pas oublier que le participe passé d’un verbe à la voix passive s’emploie avec l’auxiliaire être et s’accorde donc avec le sujet. Ex. : Elles n’ont pas été surprises par la neige.
- En expression écrite, il est très important de respecter les règles de construction des phrases négatives. À l’oral, le ne est très souvent oublié, mais un tel oubli ne peut être toléré à l’écrit, ni pour le niveau de langue courant ni, à plus forte raison, pour le niveau soutenu.
- Lorsque le sujet d’expression écrite invite à l’écriture d’un dialogue, il faut veiller avec soin à la ponctuation : il faut avant tout ne jamais oublier la ponctuation finale et, d’autre part, les différents points doivent être correctement utilisés. La ponctuation fait partie des compétences grammaticales élémentaires évaluées au Brevet.
- La présence d’une virgule ne suffit pas à conclure en faveur de la juxtaposition. Seuls le point-virgule et les deux points sont des indices certains.
- La coordination ne se réduit pas à la liste connue des conjonctions de coordination : un adverbe peut également coordonner deux propositions.
- Il ne faut pas se dire qu’une phrase simple est systématiquement une phrase courte. Les compléments circonstanciels peuvent être nombreux. Ex. : [Le soir], [à partir de sept heures], [été comme hiver], le quartier s’éveille. Cette phrase comporte trois compléments circonstanciels de temps.
- Pour reconnaître les propositions subordonnées circonstancielles, on peut le plus souvent faire un test de suppression et de déplacement (ce test ne convient pas toujours, en particulier pour les subordonnées de conséquence).
- Il ne faut pas confondre subordonnée relative et subordonnée interrogative indirecte introduite par qui.
Ex. : Je vois Saïd [qui vient]. / J’ignore [qui vient à cette soirée].
[sub. relative] [sub. interrogative indirecte]
- Il ne faut pas confondre subordonnée circonstancielle de condition et subordonnée interrogative indirecte introduite par si.
Ex. : J’irai à cette soirée [si vous y allez]. / J’ignore [s’ils y vont].
[sub. circ. de condition] [sub. interrogative indirecte]
Les compétences en orthographe
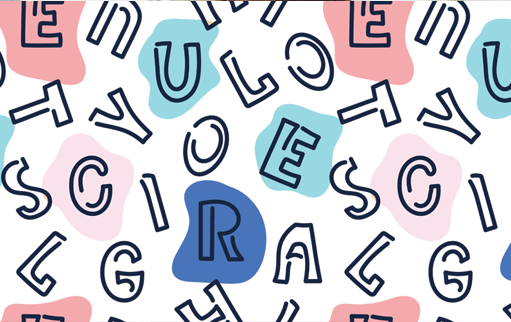
- Pour ne pas commettre d’erreurs lors de la rédaction d’un récit à la première personne, il est essentiel de bien distinguer l’imparfait du passé simple pour les verbes du 1er groupe.
- Pour ne pas confondre certaines formes homophones du présent et du subjonctif aux trois personnes du singulier, il faut changer de personne et utiliser nous ou vous.
- Pour ne pas passer à côté d’une forme composée, il faut tenir compte du fait que l’auxiliaire et le participe passé peuvent être séparés par plusieurs mots. Ex. : Elle n’a, de toute sa vie, jamais vu de koala.
- Il faut éviter de confondre le passé simple et l’imparfait du subjonctif à la troisième personne du singulier. Ex. : Il se perdit dans la foule du métro. (passé simple) / Elle craignait qu’il se perdît dans la foule du métro. (subjonctif imparfait)
- Il ne faut pas oublier que les verbes en -cer prennent une cédille devant le -a- et le -o-. Ex. : nous commençâmes ; nous renonçons.
- Il ne faut pas oublier que les verbes en -ger prennent un -e- devant le -a- et le -o-. Ex. : elle songeait ; nous prolongeons.
L’accord sujet-verbe présente de nombreux pièges. Voici quelques conseils pour les éviter lors de la dictée :
- Le sujet ne se trouve pas toujours à proximité du verbe. Il peut être séparé de celui-ci par plusieurs compléments. Cet éloignement peut rendre son repérage difficile. Il faut donc extraire méthodiquement le sujet de la phrase en utilisant la tournure : C’est... qui...
- La position du sujet n’est pas fixe. Il est quelquefois inversé.
- Lorsque le sujet est GN étendu (c’est-à-dire un GN comportant des expansions du nom), il faut repérer le nom noyau du GN qui impose l’accord du verbe. Ex. : [Ce chemin tortueux et difficile des forêts du Périgord] se voit à peine sur la carte.
- Lorsque plusieurs sujets sont repris par un dernier sujet, l’accord ne se fait pas avec l’ensemble des sujets, mais avec le dernier sujet. Ex. : Le volley, le handball, le basketball, [tout le sport de salle français] participait à ce tournoi.
- Un sujet peut « commander » plusieurs verbes. Ex. : Elle se levait, faisait une toilette de chat, courait à la faculté, travaillait une heure en bibliothèque, rejoignait ensuite l’amphithéâtre, et sautait parfois l’heure du repas. Le dernier verbe, « sautait », est particulièrement éloigné du sujet « elle » en début de phrase.
- Lorsqu’un verbe a plusieurs sujets singuliers, l’accord se fait au pluriel. Ex. : [La candidature d’Audrey], [celle de Mehdi] et [celle de Nadia] ont obtenu le plus de voix.
- Cas particulier des noms collectifs Lorsqu’un GN comporte un nom collectif (une bande, une troupe, une foule...), le nom collectif est le plus souvent considéré comme le noyau du groupe sujet. L’accord se fait alors au singulier. Ex. : [Une foule de supporters] attendait le Quinze de France à l’aéroport.
- Toutefois, l’accord peut se faire au pluriel si l’idée de nombre l’emporte. Ex. : [Une multitude de policiers] surveillaient l’ambassade des États-Unis.
Les homophones doivent faire l’objet d’un soin tout particulier lors de la dictée.
- Chaque erreur coûte 0,5 point. Il faut donc y être particulièrement vigilant, d'autant que l'on est souvent plus attentif aux accords ou à l’orthographe d'un mot difficile ou rare.
- Par exemple, dans la phrase : « Ses lunettes étaient étranges : une branche était rafistolée avec du sparadrap et leurs verres semblaient tout poussiéreux », beaucoup de candidats réfléchiront longuement aux mots « sparadrap » et « rafistolée », mais oublieront les homophones (ses /ces ; leur/leurs ; tout/tous). Pourtant une erreur sur « sparadrap » ou « rafistolée » ne coûterait « que » 0, 25 point (sauf si l’accord de « rafistolée » avec « une branche » n’est pas respecté).
- Il faut donc réfléchir aussi de façon stratégique aux erreurs possibles et savoir ce qu’il faut surveiller avant tout.
Les compétences en écriture
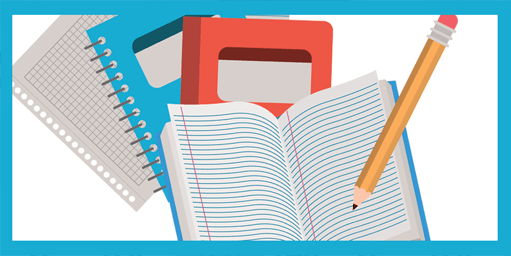
- Lorsqu’une question porte sur le genre du texte, il ne faut jamais répondre simplement qu’il s’agit d’un récit. Il faut indiquer si le texte relève du roman, de la nouvelle ou encore du récit autobiographique en s’aidant du paratexte et d’indices précis à l’intérieur de l’extrait.
- Dans le cas du roman et de la nouvelle, on peut parfois préciser davantage le genre : roman / nouvelle historique, roman / nouvelle fantastique, roman / nouvelle de science-fiction, etc.
- Une maladresse très fréquente à éviter impérativement : malgré que n’existe pas. On ne doit pas écrire : « Malgré qu’il ait raison... » mais bien : « Bien qu’il ait raison... » ou encore « Malgré la justesse de son raisonnement... ».
- Attention à ne pas confondre ces deux homophones :
– quoique (en un seul mot) signifiant « bien que »,
– quoi que signifiant « quelle que soit la chose que... ».
Ex. : Quoiqu’il soit très convaincant, il dissimule une partie de la vérité. / Quoi qu’il invente pour nous convaincre, nous avons un doute sérieux sur les faits présentés.
- Pour tout sujet de réflexion, il ne faut surtout pas oublier de formuler clairement la thèse défendue (elle doit toujours être énoncée sous la forme d’une phrase simple) puis de faire un plan au brouillon. Les devoirs mal notés au Brevet sont très souvent ceux qui ne respectent pas ces deux étapes.
© Editions Bordas. Tous droits réservés. Reproduction interdite.
Complète tes révisions avec Bordas soutien scolaire !

Pour aller plus loin dans tes révisions !
Découvre notre plateforme d’entraînement en ligne Bordas soutien scolaire ! Au programme : des cours, des exercices interactifs, des vidéos, des tests de positionnement et un module de révisions spécial examens…!
La plateforme est accessible sur ordinateur ou tablette, à tout moment, avec ou sans connexion internet !
Et l’abonnement est à partir de 3,99€ seulement !
Plus d’excuses pour ne pas être prêt pour les examens !

