
Réviser la philosophie en Terminale
La philo est la première épreuve du bac et elle est évaluée non seulement sur les connaissances des notions mais aussi des plus grands penseurs. Révise le programme à travers les notions clés et leurs auteurs et un lexique avec les concepts philosophiques fondamentaux pour toutes les filières.
Pour aller plus loin, découvre nos conseils avec les erreurs à éviter à l'épreuve de philo.
Les différents auteurs et les notions à retenir en philosophie en terminale
Réussis le bac de philosophie en revoyant les grands noms et leurs pensées qui ont marqué l’histoire de la philosophie.
BERGSON – Philosophe français (1859-1941)
Notions concernées : conscience, inconscient, temps, langage, matière et esprit, religion, morale
Principales œuvres : Essai sur les données immédiates de la conscience (1889) ; Le Rire (1900) ; L’Énergie spirituelle (1920) ; Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932).
Bergson veut réconcilier la philosophie avec la vie. Il privilégie la perception des choses sur leur abstraction et oppose deux ordres : d’un côté l’ordre homogène de l’espace et du déterminisme; de l’autre, l’ordre des faits intérieurs de la conscience, marqués par l’hétérogénéité de la durée et la liberté.
Pour Bergson, le langage procède de l’extériorité ; il ne peut saisir la complexité de la pensée. Cela reprend la thèse romantique de l’ineffable (l’indicible) qui, échappant à toute formulation, ne peut être saisi que par l’intuition.
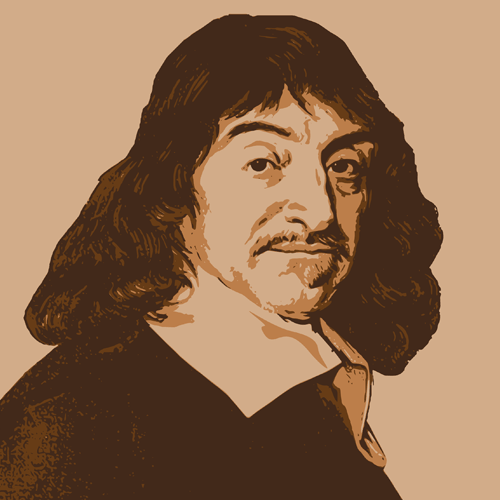
DESCARTES – Philosophe français (1596-1650)
Notions concernées : conscience, perception, démonstration, matière et esprit, vérité
Principales œuvres : Discours de la méthode (1637) ; Méditations métaphysiques (1640) ; Principes de philosophie (1644).
Le point de départ de Descartes est le doute radical, qui permet de distinguer le vrai du faux. Pour débarrasser l’esprit des idées fausses et des préjugés qui l’encombrent, il faut douter de tout. Or, il y a une chose que je ne peux pas mettre en doute, c’est que j’existe en tant qu’être qui doute. Je doute (ou je pense), donc je suis : le cogito est le principe duquel découlent d’autres vérités.
EPICTETE – Philosophe grec stoïcien, esclave affranchi, fondateur d’une école de philosophie (50-125)
Notions concernées : désir, liberté, bonheur
Principales œuvres : Entretiens (vers 130) ; Manuel (vers 130).
Pour Épictète, l’homme sage est celui qui a atteint une complète ataraxie (du grec ataraxia, « absence de trouble »). La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent et non comme nous le désirons. L’ordre universel s’impose comme une nécessité ou un destin (fatum). Ainsi la seule chose qui dépend de nous, c’est le jugement que nous portons sur ce qui ne dépend pas de nous.
EPICURE – Philosophe grec (341-270)
Notions concernées : désir, bonheur
Principales œuvres : Lettre à Ménécée
Épicure décrit un monde sans finalité, sans providence ou destin, et qui n’obéit qu’à des causes mécaniques. L’âme est un assemblage d’atomes. La mort n’est donc qu’un événement naturel et non pas la menace d’un châtiment ou la promesse d’une béatitude. Les dieux n’interviennent pas dans le monde. Le sage ne doit pas se mêler de politique et ne craint ni les dieux ni la mort.
FREUD – Neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse (1856-1939)
Notions concernées : conscience, inconscient, religion, liberté
Principales œuvres : L’Interprétation des rêves (1899) ; Introduction à la psychanalyse (1917) ; Nouvelles Conférences sur la psychanalyse (1933).
Freud a attaché son nom à la découverte de l’inconscient. Freud pose l’hypothèse de l’inconscient comme nécessaire et légitime, parce qu’elle permet de fonder une pratique efficace : la cure psychanalytique. Les actes manqués, les rêves, les lapsus sont des manifestations précieuses de l’inconscient.
HEGEL – Philosophe allemand (1770-1831)
Notions concernées : conscience, autrui, art, histoire, religion, société, État, liberté
Principales œuvres : La Phénoménologie de l’Esprit (1807) ; Esthétique (1818-1829) ; La Raison dans l’histoire (1837).
Pour Hegel, l’histoire peut être considérée comme rationnelle. Elle a un sens, une direction. La fin de l’histoire, c’est-à-dire la fin des guerres et de la violence, s’accomplit lorsque la raison, l’esprit et la liberté (lois de l’esprit ou de l’absolu) deviennent le fondement des lois de l’État.
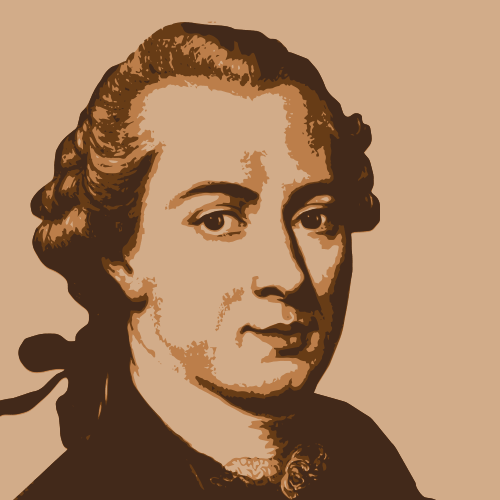
KANT – Philosophe allemand (1781-1804)
Notions concernées : perception, art, vérité, histoire, morale, devoir, bonheur
Principales œuvres : Critique de la raison pure (1781) ; Critique de la raison pratique (1788) ; Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) ; La Religion dans les limites de la simple raison (1794).
Pour Kant, l’homme ne peut connaître que ce qui est donné dans l’expérience: on ne peut prouver que l’âme existe ou que Dieu existe (Critique de la raison pure). Kant ruine ainsi l’ancienne métaphysique qui prétendait s’ériger en science. Il affirme que le bonheur de l’homme ne peut s’accomplir dans l’indignité et qu’il faut avant tout remplir son devoir (Critique de la raison pratique). Dans La Religion dans les limites de la simple raison, il montre qu'une philosophie de l'espérance n'est pas vaine : postuler l'immortalité de l'âme permet d'espérer la rencontre de la vertu et du bonheur.
MACHIAVEL – Philosophe et penseur politique italien (1469-1527)
Notions concernées : politique, société, État
Principales œuvres : Le Prince (1513).
La pensée politique de Machiavel s’est forgée au fil de ses nombreuses missions diplomatiques, à la cour papale, à la cour de France… « On ne fait pas, dit-il, de bonne politique avec de bons sentiments. » Afin de conserver le pouvoir, le prince doit avoir la ruse du renard « pour connaître les filets » et la force du lion « pour faire peur aux loups ». Rousseau dira qu’en donnant des conseils aux princes sur la façon de manipuler les foules, Machiavel aurait, en fait, éclairé les peuples sur la manière dont ils sont trompés.
MARX – Philosophe allemand (1818-1883)
Notions concernées : travail, technique, politique, société, échanges, État, histoire, religion, liberté, bonheur
Principales œuvres : L’Idéologie allemande (1846) ; Critique de la philosophie du droit de Hegel (1844) ; Manuscrits de 1844 ; Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte (1852), Le Capital (1867).
Marx renverse la dialectique hégélienne (cf. Hegel) en remplaçant le terme d’« absolu » par celui d’« homme », et celui de « conscience divine » par « conscience humaine » (c’est le matérialisme dialectique). Pour lui, le développement historique est régi par des lois économiques et notamment par la lutte entre les classes exploitantes et les classes exploitées (matérialisme historique) : il montre que le système capitaliste repose sur l’exploitation du travail salarié.
NIETZSCHE – Philosophe allemand (1844-1900)
Notions concernées : conscience, inconscient, temps, vérité, morale, devoir, bonheur
Principales œuvres : Humain, trop humain (1878) ; Aurore (1881) ; Le Gai Savoir (1882) ; Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885).
Pour Nietzsche, le monde est un ensemble dynamique qui ne cesse de se détruire et de se recréer car il est animé d’une « volonté de puissance », d’une force de vie perpétuelle. C’est la thèse de l’éternel retour. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche annonce la venue du surhomme, créateur de valeurs nouvelles et forme transcendée de l’homme, incarnation accomplie de la volonté de puissance.
PLATON – Philosophe grec, fondateur d’une école philosophique et discipline de Socrate (428-347 av. J.-C.)
Notions concernées : perception, désir, existence, vérité
Principales œuvres : Le Banquet (ive siècle av. J.-C.) ; La République (ive siècle av. J.-C.).
L’oeuvre de Platon est une longue interrogation sur le statut et la fonction du philosophe dans la cité. Les philosophes sont ceux qui parviennent à atteindre "ce qui existe toujours d'une manière immuable" (les Idées ou essences). Pour Platon, la fin ultime de la philosophie est de contempler la vérité, alors que la sophistique, autre mouvement philosophique, ne fait connaître que les apparences en utilisant la force de persuasion de la rhétorique.
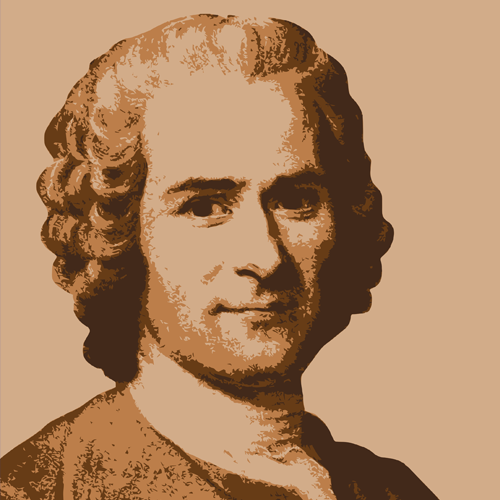
ROUSSEAU – Ecrivain et philosophe français (1712-1778)
Notions concernées : autrui, politique, société, État, liberté
Principales œuvres : Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) ; Du contrat social (1762) ; Émile ou de l’Éducation (1762).
Pour Rousseau, la propriété privée est la source de l’inégalité. Dans le Contrat social, il cherche à concilier les libertés individuelles avec les exigences de la vie en société : le droit ne doit pas être engendré par la force mais doit reposer sur un contrat social. Chaque membre est un citoyen, à la fois partie indivisible du tout (en tant qu’il participe au vote des lois) et sujet (en tant qu’il y obéit). Obéir à la loi qu’on s’est prescrite est liberté.
SARTRE – Ecrivain et philosophe français (1905-1980)
Notions concernées : conscience, inconscient, perception, autrui, existence et temps, liberté
Principales œuvres : L’Être et le Néant (1943) ; L’existentialisme est un humanisme (1946) ; Critique de la raison dialectique (1960).
La thèse fondamentale de l’existentialisme sartrien est que l’homme n’a pas d’essence préalable et se trouve condamné à choisir librement son essence. L’homme est ce qu’il se fait, et c’est en cela qu’il se différencie de toute autre réalité. Exister, c’est assumer cette liberté. L’homme n’est pas seulement responsable de ce qu’il est : chacun de ses choix engage l’humanité tout entière.
SPINOZA – Philosophe hollandais (1632-1677)
Notions concernées : désir, société, politique, État, bonheur, liberté
Principales œuvres : Traité théologico-politique (1670) ; L’Éthique (1667).
Dans le Traité théologico-politique, Spinoza critique la Bible d’un point de vue rationnel, en montrant les contradictions qui y sont à l’oeuvre. Pour Spinoza, ce qui définit l’homme, c’est l’effort, le conatus que chaque être déploie pour persévérer dans l’existence. Or, cette force d’exister, toujours orientée vers l’obtention d’un bien, se donne concrètement comme désir. Le désir dans sa profondeur est toujours désir d'accroître sa puissance d'exister. Il ne faut donc pas combattre les désirs, mais faire en sorte qu'ils puissent se réaliser pleinement.
Les définitions de concepts fondamentaux en philosophie
Tous les grands repères de philosophie regroupés dans un lexique afin d’exceller à l’épreuve de philosophie !

- Absolu/relatif
• Absolu désigne ce qui vaut ou existe en soi-même, indépendamment de conditions concrètes. Ainsi, Dieu existe en lui-même : il n’a ni commencement ni fin, il est cause de lui-même.
• Est relatif ce qui dépend de conditions concrètes.
- Abstrait/concret
• L’abstrait est le résultat de l’abstraction. Celle-ci consiste à ne retenir d’un ensemble d’êtres ou de choses que ce qu’ils ont de commun. Ex. : l’abstraction « arbre » abandonne toute particularité sensible et concrète pour ne garder que ce qui est commun à la classe (un tronc, des branches).
• Le concret fait référence à des objets particuliers tels que l’expérience nous les fournit.
- En acte/en puissance
• Selon Aristote, l’être en puissance est entre le néant et l’être. Il n’est qu’un possible.
• L’être en acte est achevé et réalisé. Ex. : un bloc de marbre n’est pas une statue en lui-même, il l’est seulement dès lors qu’il a telle ou telle forme. Ainsi, la matière informe est apte à prendre forme, à être « actualisée ».
- Aliénation
• Être aliéné signifie être dépossédé de soi, être étranger à soi, être autre que soi. Juridiquement, l’aliénation est la dépossession d’un bien ou d’un droit.
• En psychologie, c’est une maladie mentale qui dépossède l’individu de sa personne et de ses biens.
• En philosophie, c’est l’asservissement de l’homme, par l’idéologie, par les progrès de la technique…
- Causalité/finalité
• La causalité désigne le rapport nécessaire de la cause à l’effet. Selon le principe de causalité, tout phénomène a une cause.
• La finalité est ce vers quoi tend une chose, une action. On distingue la finalité interne (ex. : chez les êtres vivants, les organes sont adaptés à une fin qui est la conservation de la vie) et la finalité externe (ex. : le fait qu’un objet soit conforme à sa fonction).
- Cause/fin
• La cause est ce qui est à l’origine d’un phénomène ; c’est aussi la raison permettant d’expliquer une chose ou
une action.
• La fin désigne à la fois l’état final d’une chose, d’une action et le but qu’elle vise.
- Contingent/nécessaire/possible
• Est contingent ce qui peut être ou ne pas être. Ex. : un meuble fabriqué par un artisan.
• Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Ex. : la loi de la chute des corps.
• Est possible ce qui n’est pas encore réel mais qui peut le devenir.
- Déduction
Dans la logique classique, c’est un raisonnement par lequel on tire des conclusions nécessaires à partir de propositions initiales appelées prémisses.
- Déterminisme
Principe selon lequel tout ce qui arrive est rigoureusement déterminé par des phénomènes antérieurs : les mêmes causes produisent les mêmes effets. C’est ce qui rend possible l’expérimentation scientifique.
- Empirisme/rationalisme
• L’empirisme est une philosophie qui affirme que l’expérience sensible est la seule source de connaissance.
• Le rationalisme affirme au contraire la primauté de la raison sur les sens dans la recherche de la connaissance. Plus généralement, le rationalisme est une attitude d’esprit scientifique et critique qui s’oppose à l’irrationalisme, à la superstition.
- En fait/en droit
• En fait signifie « ce qui est effectivement ».
• En droit désigne ce qui est légal, ce que la loi autorise.
• Ce qui est possible en fait ne l’est pas toujours en droit, et inversement. Ex. : le droit au travail reste purement formel si, dans les faits, ceux qui veulent travailler ne le peuvent pas.
- En théorie/en pratique
• « En théorie » (du grec theôria, « action de contempler ») fait référence à quelque chose d’abstrait, de désintéressé.
• « En pratique » (du grec pratikê, « science pratique ») fait référence à l’action, au concret.
• Ce qui est vrai en théorie ne l’est pas toujours en pratique.
- Essence/accident/existence
• Par opposition à l’accident : essence est synonyme de substance. C’est l'ensemble des caractères constitutifs d'une chose ou d'un être (ex. : Paul est généreux). L’accident désigne au contraire un caractère secondaire, qui peut être modifié sans affecter l’essence (ex. : Paul est français).
• Par opposition à l’existence : essence est synonyme de concept. C’est la définition d’une chose ou d’un être, indépendamment de son existence dans la réalité concrète. Ex. : l’essence du carré, c’est d’être une figure à quatre côtés égaux, à quatre angles droits, alors que le carré existant est celui que je trace au tableau.
- Éthique
Étude critique de la vie et des valeurs morales. Partie constitutive de la philosophie.
- Expliquer/comprendre
• L’explication détermine des causes et formule des lois. Ex. : les sciences physiques expliquent objectivement les faits, sans chercher à comprendre le sens du monde.
• Comprendre, c’est découvrir le sens. On peut comprendre une chose en la vivant ou en se mettant à la place de ceux qui la vivent (par communication sympathique ou empathique). Ex. : les sciences humaines cherchent à comprendre car, pour les faits humains, la détermination des causes est souvent incertaine et les lois sont peu nombreuses.
- Identité/égalité/différence
• L’identité (du latin identitas, « le même ») est le caractère de ce qui est semblable à quelque chose ou qui reste le même à travers le temps.
• L’égalité en droit est le fait que les hommes se présentent de façon identique devant la loi. En mathématiques, l’égalité est la propriété de deux quantités qui sont équivalentes ou substituables l’une à l’autre.
• La différence est un rapport d’altérité entre des choses ou des êtres ayant des éléments identiques.
- Immanence/transcendance
• L’immanence (du latin in manere, « rester dans ») est le caractère de ce qui réside à l'intérieur d'une chose. Ex. : pour Spinoza, Dieu est immanent car il s'identifie à la nature.
• Par opposition, la transcendance désigne l’appartenance à un ordre supérieur. Ex. : pour le christinianisme, Dieu est un être transcendant.
- Immédiat/médiat
• Est immédiat ce qui ne passe pas par des médiations. Ex. : l’intuition, qui ne nécessite pas la médiation des concepts.
• Est médiat ce qui passe par des médiations.
- Inhérent/intrinsèque
• Est inhérent ou intrinsèque ce qui appartient à la nature ou à la définition d’un être ou d’un objet. Ex. : le langage est inhérent à la nature de l’homme.
- Intuitif/discursif
• Est intuitif ce qui est saisi immédiatement, sans recours au raisonnement. C’est une connaissance immédiate qui n’est pas directement explicable par un discours.
• Est discursif ce qui recourt au raisonnement, à la démonstration logique mise en discours.
- Légal/légitime
• Est légal est ce qui est conforme à la loi.
• Est légitime ce qui est conforme aux idéaux de l’équité, de la justice, de la morale.
- Métaphysique
• Le métaphysique est ce qui est au-delà du physique, ce qui transcende le monde naturel.
• La métaphysique est la réflexion qui a pour objet l’être en tant qu’être, la recherche des causes de l’univers et des principes de la connaissance.
- Objectif/subjectif
• Est objectif ce qui est vrai, universel, indépendant du sujet connaissant. Ex. : les sciences prétendent à l’objectivité (synonyme de « vérité » en sciences).
• Est subjectif ce qui est particulier, relatif au sujet. Ex. : dire « la couleur violette est belle » est un jugement subjectif.
- Obligation/contrainte
• Au sens moral, l’obligation est l’impératif,le devoir dicté par la conscience ou la raison. Elle suppose la possibilité de désobéir car il n’y a devoir que lorsqu’il y a liberté.
• Par opposition, la contrainte est l’impératif imposé par la force… qui entrave la liberté.
- Ontologie
• Science de l’être en tant qu’être. Partie de la métaphysique.
- Persuader/convaincre
• Persuader, c’est emporter l’adhésion du locuteur par la séduction du discours, en touchant sa sensibilité. Ainsi, les sophistes ou les rhéteurs visent à faire croire que ce qu’ils disent est vrai.
• Convaincre, c’est amener le locuteur à reconnaître la vérité d’une proposition grâce à une argumentation raisonnée et logique.
- Positivisme
• Philosophie d’Auguste Comte (milieu du XIXe siècle) qui affirme que la connaissance scientifique représente la maturité de l’esprit humain. Par extension, le positivisme désigne toute doctrine qui affirme que le progrès de la connaissance et le progrès social dépendent exclusivement de celui des sciences.
- Pragmatisme
Philosophie développée par William James (deuxième moitié du XIXe siècle), qui fait de l’utilité pratique le seul critère du vrai. Est vrai, en somme, ce qui réussit.
- Principe/conséquence
• Un principe (du latin principium, « commencement ») est une proposition première, à partir de laquelle on déduit des conséquences. Ex. : en maths, les principes de la géométrie d'Euclide sont indémontrés et sont le point de départ de toute démonstration.
• La conséquence est ce qui est dérive logiquement du principe.
- Sensualisme
Conception selon laquelle toutes les connaissances viennent des sens.
- Universel/général/particulier/singulier
• Est universel ce qui vaut pour tous. Ex. : les jugements scientifiques.
• Est général ce qui est obtenu par induction, c’est-à-dire par la généralisation d’une expérience. Mais une nouvelle expérience peut venir invalider ce qui a été induit.
• Est particulier ce ne vaut que pour quelques-uns. Ex. : certains hommes sont des mathématiciens.
• Une proposition est singulière si elle ne vaut que pour un seul. Ex. : Socrate est un sage.
© Editions Bordas. Tous droits réservés. Reproduction interdite.
Complète tes révisions avec Bordas soutien scolaire !

Pour aller plus loin dans tes révisions !
Découvre notre plateforme d’entraînement en ligne Bordas soutien scolaire ! Au programme : des cours, des exercices interactifs, des vidéos, des tests de positionnement et un module de révisions spécial examens…!
La plateforme est accessible sur ordinateur ou tablette, à tout moment, avec ou sans connexion internet !
Et l’abonnement est à partir de 3,99€ seulement !
Plus d’excuses pour ne pas être prêt pour les examens !

